23/09/2018
nouveaux délits 61
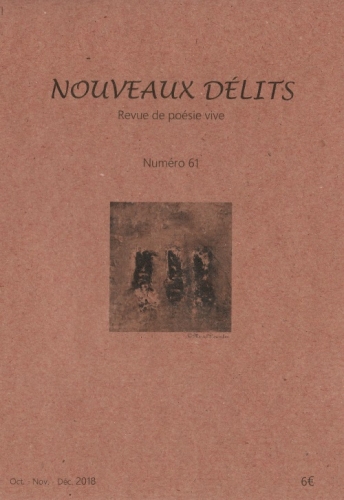
octobre 2018
Quand j’ai commencé la revue, dans les premiers numéros, j’étais systématiquement au sommaire. C’était une façon de faire connaître mon travail en même temps que celui des autres auteurs que j’accueillais. Puis devant leur nombre sans cesse croissant et lassée aussi de ma présence, j’ai libéré la place avec joie. Mais le problème des poètes revuistes, comme ces cordonniers (quand il y en avait) mal chaussés, c’est qu’à force de se mettre au service de l’écriture des autres, ils n’ont plus beaucoup, voire plus du tout de temps pour la leur. Il y a aussi un fait : la réciprocité chez les êtres humains — et les poètes ne font pas exception — ne coule pas de source, c’est pourquoi le proverbial « jamais aussi bien servi que par soi-même » prend au final tout son sens.
Alors pour une fois, je reprends un bout de territoire ici, juste le temps de mettre un coup de projecteur entre autre sur la sortie d’un livre à lente maturation auquel je tiens et que publient les éditions Cardère, qui hébergent déjà trois autres de mes bébés. La bonne maison Cardère publie avant tout des ouvrages sur le pastoralisme, la poésie c’est en plus et elle n’a jamais eu l’imbécile idée de choper la grosse tête ou de s’illusionner sur un quelconque pouvoir d’éditeur, pas plus qu’elle ne s’illusionne sur les auteurs eux-mêmes. Une chose est essentielle en poésie — et qui dit poésie, dit vie — : une forme d’humilité. Pas une posture humble non, juste quelque chose de très naturel, humus, humilité, humain, cette racine plantée dans la terre qui nous nourrit et qu’il ne faut jamais oublier, quelle que soit la force et l’envolée de notre imaginaire ou de nos prétentions.
Écrire est une chose, être lu en est une autre. Entre les deux se tissent de fragiles et éphémères passerelles dans lesquelles se prend la rosée de l’aube, trésor qui scintille un instant — précieux instant — avant que le jour ne vienne le boire.
CG
monde de rosée
rien qu'un monde de rosée
pourtant et pourtant
Issa

illustrations : Muriel Dorembus
17:09 Publié dans culture | Lien permanent | Commentaires (0)
18/09/2018
En France, les plus pauvres paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches
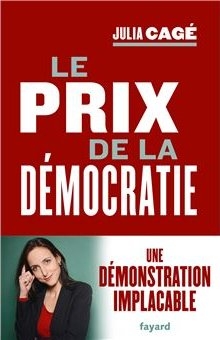
Le prix d’un vote ? 32 €.
Dans son dernier livre, l’économiste soutient, chiffres inédits à l’appui, que l’argent a un rôle déterminant dans le résultat d’une élection. Pire : l’Etat subventionne davantage les orientations politiques des plus aisés, favorisant ainsi les partis de droite.
La France est-elle vraiment protégée des groupes de pression ? Sans doute moins qu’elle aimerait le croire. Notre démocratie repose-t-elle sur l’équation «un homme = une voix» ? Pas tout à fait, selon Julia Cagé. Après avoir étudié le financement des médias (Sauver les médias, Le Seuil, 2015), l’économiste, professeure à Sciences-Po Paris, poursuit son exploration des ressorts et des inégalités de notre système représentatif. A partir d’une base de données inédite des financements publics et privés de la vie politique, aux Etats-Unis, en France ou ailleurs en Europe, elle démontre dans son dernier livre, le Prix de la démocratie (Fayard), que ces questions, en apparence techniques, pourraient bien avoir leur rôle dans le sentiment d’abandon des classes moyennes et populaires, et dans la montée des populismes (1). Car, non seulement l’expression politique est capturée par les intérêts privés des plus riches, mais cette confiscation peut avoir un sacré impact sur le résultat des élections. En France, depuis les années 90, le financement de la vie politique est fondé sur quelques grands principes : les dons des particuliers sont encadrés (pas plus de 7 500 euros pour les partis par individu et par an, pas plus de 4 600 euros par élection) ; les entreprises ne peuvent verser des fonds aux candidats ; en contrepartie, l’Etat finance une grande partie de la vie politique. Un système bien imparfait, révèle Julia Cagé, qui subventionne en réalité les préférences politiques des plus riches et favorise donc les partis de droite.
«Qui paie gagne», écrivez-vous : en France aussi, l’argent fait l’élection. Cela explique l’improbable accession au pouvoir d’Emmanuel Macron, candidat sans parti ni élu ?
C’est un cas exemplaire. J’ai commencé à travailler sur le financement de la vie politique en 2014. L’une de mes hypothèses était qu’il fallait une réforme urgente du système de financement public des partis politiques, car il favorise l’immobilisme : l’argent donné par l’Etat aux candidats dépend des résultats obtenus aux dernières législatives. Ça ne permet pas l’émergence de nouveaux mouvements… sauf à attirer suffisamment de dons privés pour compenser ce handicap. Ce n’était encore jamais arrivé en France. C’est exactement ce que Macron a réussi à faire. Fin 2016, En marche !, né en avril, a déjà réuni 4,9 millions d’euros de dons privés. Contre 7,45 millions d’euros pour Les Républicains et seulement 676 000 euros pour le PS. L’innovation politique ne peut pas naître sans être financée. Or, dans toutes les démocraties occidentales, les dons privés vont d’abord aux partis conservateurs qui prônent une politique économique favorable aux plus aisés.
Quel est le profil des donateurs ?
On pourrait imaginer que les classes populaires donnent massivement, même pour de faibles montants. Ce n’est pas le cas. En France - comme aux Etats-Unis, en Italie ou en Grande Bretagne -, ce sont les plus aisés qui financent la vie politique. Ils ne sont d’ailleurs pas nombreux. Chaque année, seuls 290 000 foyers fiscaux français font un don, 0,79 % des Français adultes. Mais si on regarde parmi les 0,01 % des Français aux revenus les plus élevés, on s’aperçoit que 10 % d’entre eux font un don. Et ces 0,01 % des Français les plus riches versent en moyenne 5 245 euros par an. Les 50 % des Français les plus pauvres donnent, eux, quand ils donnent, seulement 120 euros par an en moyenne. Mais le scandale, c’est que les dons privés des plus aisés sont financés par l’ensemble des citoyens.
Pourquoi ?
Il existe trois formes de financements publics de la démocratie. La première, c’est celui des partis politiques, déterminé tous les cinq ans en fonction des résultats aux législatives : il s’élève à 63 millions d’euros. La deuxième, c’est le remboursement des dépenses de campagnes : 52 millions d’euros par an en moyenne. Et la troisième, dont on ne parle jamais, ce sont les déductions fiscales : votre don à un parti politique est remboursé à 66 %, par le biais d’une réduction d’impôt. Ces réductions représentent 56 millions d’euros par an pour les seuls dons aux partis politiques ! 56 millions d’euros offerts à seulement 290 000 individus qui ont choisi de financer un parti ? Même pas ! Car on ne peut bénéficier de déductions d’impôt… que si on paie l’impôt sur le revenu, ce qui n’est le cas que d’un Français sur deux. Pour le dire autrement si vous êtes parmi les 10 % des Français les plus fortunés, et que vous faites un don de 7 500 euros, celui-ci vous reviendra au final à 2 500 euros. Et le coût de votre don pour l’ensemble des citoyens sera de 5 000 euros. Mais, si vous êtes smicard, étudiant ou travailleur précaire, et que vous donnez 600 euros à un parti, votre générosité vous reviendra à… 600 euros, puisque vous n’êtes pas imposable sur le revenu. Bref, en France, les plus pauvres paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches.
Le financement de la vie politique expliquerait la «droitisation» des gauches occidentales ?
Si tous les partis et les candidats recevaient autant de financements privés, ce ne serait pas forcément problématique. Mais ce n’est pas le cas. Les Républicains touchent en moyenne, en France, 11 fois plus de dons privés que le Parti socialiste. On retrouve exactement le même déficit dans les autres pays. Or, on s’aperçoit qu’au Royaume-Uni avec Tony Blair, aux Etats Unis avec Hillary Clinton, en Italie avec Renzi, les partis de gauche se sont engagés dans une course aux financements privés. Ils abandonnent leur électorat populaire pour promouvoir des politiques économiques favorables aux plus aisés.
Un parti peut-il vraiment «acheter» les électeurs ?
J’ai analysé, avec Yasmine Bekkouche, doctorante à l’Ecole d’économie de Paris, toutes les élections municipales et législatives en France depuis 1993. Le résultat est net : statistiquement, en moyenne, les candidats les plus dotés et qui dépensent le plus remportent les élections. Bien sûr il y a des exceptions - le cas de Benoît Hamon à la présidentielle le prouve. J’ai estimé le prix d’un vote à 32 euros. Si un candidat met 32 euros de plus que son concurrent dans une campagne, il récolte une voix de plus. Au fond, ce n’est pas très cher un vote…
Mais la victoire d’un candidat plus riche peut aussi s’expliquer par son talent ?
Nous avons neutralisé l’effet de la popularité d’un parti une année donnée, le taux de chômage local, le niveau d’éducation moyen et les revenus fiscaux de la circonscription, le nombre de créations d’entreprises localement, le niveau d’investissement de la municipalité, etc. Résultat : toutes choses égales par ailleurs, le budget d’une campagne a bien un impact sur le résultat d’une élection. Mieux, selon nos analyses, l’«étrange défaite» de la droite après la dissolution surprise de Jacques Chirac en 1997, pourrait s’expliquer par l’interdiction, en 1995, des dons des entreprises aux campagnes électorales. Elle n’a eu d’effet que pour les candidats de droite qui touchaient des dons importants venant d’entreprises.
Comment expliquer que l’argent ait un tel rôle ?
Les meetings coûtent chers, comme les frais de transports, les conseils en communication et toutes les stratégies qui reposent sur l’utilisation des big datas. Cette utilisation des réseaux sociaux a d’ailleurs un effet pervers. Dans un monde où un candidat pourrait cibler ses électeurs, et si quelques milliardaires peuvent aider une campagne plus sûrement que des milliers d’électeurs, c’est sur cette poignée de personnes qu’il ciblera sa campagne. Encore une fois, les politiques risquent de se couper des classes populaires et moyennes.
Vous dites que les donateurs de Macron «en ont eu pour leur argent» avec la suppression de l’ISF. N’est ce pas un peu rapide ?
Derrière la formule, il y a une évidence : une personne soumise à l’ISF qui a donné 7 500 euros à la République en marche, ce qui lui est revenu à 2 500 euros, et qui voit l’ISF supprimé a effectivement fait un bon investissement. Le politiste américain Martin Gilens a comparé les souhaits des citoyens américains exprimés dans les sondages depuis 1950 (sur la politique économique, étrangère ou sociale), à leur niveau de revenus, et aux politiques effectivement mises en œuvre. Il montre que lorsqu’il y a divergence entre les Américains les plus riches et la majorité des citoyens, les gouvernements tranchent systématiquement en faveur des 1 % les plus riches. Pourquoi n’y a-t-il pas de révolution ? Gilens a une formule extraordinaire : il parle de «démocratie par coïncidence». Sur beaucoup de sujets - la légalisation de l’avortement ou l’intervention en Irak -, les plus riches sont en phase avec la majorité. Mais c’est pure coïncidence. Le salaire minimum réel, lui, a baissé depuis les années 50. Ce sentiment de dépossession alimente le populisme.
Que proposez-vous pour y remédier ?
Certainement pas de supprimer tout financement public des partis parce qu’ils seraient «pourris», comme l’a obtenu le mouvement Cinq Etoiles en Italie ! La démocratie a un prix. Si ce coût n’est pas porté de manière égalitaire par l’ensemble des citoyens, il sera capturé par les intérêts privés. Il faut au contraire renforcer le financement public de la démocratie. Je propose la création de «Bons pour l’égalité démocratique». Il ne s’agit pas de dépenser plus, mais autrement : tous les ans, an cochant une case sur sa feuille d’impôt, chaque citoyen aura la possibilité d’allouer 7 euros au mouvement politique de son choix. Il ne les sort pas de sa poche, mais il demande à l’Etat de donner 7 euros du fonds pour le financement des partis à celui de son choix.
Et quand on est abstentionniste ou antiparti ?
Alors vos 7 euros sont donnés en fonction des résultats aux dernières législatives. C’est une manière de favoriser l’émergence de nouveaux mouvements, et c’est égalitaire : un même montant fixe est alloué à chaque citoyen.
Vous supprimez les dons privés ?
Je les limite à 200 euros par an, c’est déjà beaucoup par rapport au revenu moyen français. Si on cherche l’égalité politique, on ne peut pas permettre aux citoyens de donner 7 500 euros à un parti puisque c’est un geste impossible à beaucoup.
Vous prônez également la création d’une «Assemblée mixte» où seraient mieux représentés les ouvriers et les employés. Comment sera-t-elle élue ?
Le Congrès américain compte moins de 5 % d’ouvriers et d’employés alors qu’ils représentent la moitié de la population. Aucun ouvrier ne siège aujourd’hui à l’Assemblée nationale française. Je propose de laisser inchangées les règles de l’élection des deux tiers des députés. Mais qu’un tiers de l’Assemblée soit élu à la proportionnelle intégrale, par scrutin de liste, où sera imposée une moitié de candidats ouvriers, employés, chômeurs ou travailleurs précaires. Comme pour la parité entre hommes et femmes il faut se saisir des outils de l’Etat de droit pour imposer l’égalité démocratique.
(1) Voir aussi le site Leprixdelademocratie.fr, où sont recensées toutes les données du livre et où l’on peut «tester» les hypothèses de Julia Cagé sur son propre député.
LE PRIX DE LA DÉMOCRATIE par JULIA CAGÉ Ed. Fayard, 350 pp., 23€
source : Libération
00:49 Publié dans démocratie, manipulation | Lien permanent | Commentaires (0)
17/09/2018
Aux origines des civilisations : une fiction au service de l’élite

merci à cg pour ce texte...
La science est le reflet de la société, et l’archéologie a parfois été utilisée pour alimenter des idéologies totalitaires ou fascistes. Dans Aux origines des civilisations, un documentaire en quatre volets diffusé sur la chaîne de télévision grand public Arte, l’archéologie est mise au service de l’idéologie néolibérale qui domine les cercles privilégiés des sociétés capitalistes contemporaines. Certains diront qu’il n’y a pas de science sans paradigme, que l’objectivité en ce qui concerne notre passé et notre présent est impossible. Pourtant, il y a des faits archéologiques qui permettent, en toute objectivité, de rendre compte de la mystification mise en place par le réalisateur.
Ce documentaire nous propose de plonger dans le passé des civilisations pour en comprendre la formation, la grandeur, et le danger qui les guette toutes : leur disparition. La musique et le montage participent à rendre le discours épique, glorieux, héroïque. Tout le documentaire est une glorification de « l’ascension de l’homme ». Ainsi des archéologues qui montent les degrés des ziggourats ou des échelles, de la flèche filant en ligne droite et qui symbolise le progrès, des couleurs ternes qui caractérisent la grisaille du quotidien des préhistoriques quand, par opposition, le monde moderne apparaît sous des couleurs éclatantes.
Dans le premier volet, nous apprenons que la civilisation ne peut exister sans la ville, que la civilisation est la ville. D’après les scientifiques interrogés par le réalisateur, la ville se fonde sur la sociabilité innée de l’humain, elle fonctionne comme « des cerveaux collectifs qui permettent d’accéder aux points de vues et compétences de milliers d’individus », permet de « mutualiser des connaissances pour participer à quelque chose de plus grand et de plus efficace, quelque chose qu’on ne peut pas réussir seul. » Il semblerait donc que plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons nous spécialiser et plus nous pouvons nous élever ensemble. Le psychologue évolutionniste, Michael Muthukrishna, déclare : « Les élites et les inégalités ne sont pas un mal. Une élite est nécessaire, il faut produire des richesses, mettre des armées sur pieds, faire respecter les lois, distribuer les richesses. C’est dans la ville que se trouvent les richesses et le pouvoir et que vivent les gens. » Et le spectateur contemple l’intellectuel en chemise blanche qui parade dans les rues chatoyantes de Tokyo, heureux de manger des pâtes cuisinées par un grand spécialiste de la speed food. C’est vite oublier que les pâtes qu’il engouffre goulûment et avec grande satisfaction proviennent de champs épuisés par l’exploitation intensive, que le blé a été récolté par une population qui ne vit pas dans les villes et que ces champs sont le cimetière de nombreuses espèces indispensables à la vie terrestre. Cet intellectuel est parfaitement formaté par la civilisation, il s’y promène comme un vampire dans sa propriété. Pourquoi les inégalités qu’elle engendre devraient-elles lui poser problème ? Ce n’est pas lui qui sue dans la petite arrière-cuisine, ce n’est pas lui qui s’éreinte le dos dans les travaux domestiques. Lui, l’intellectuel de la ville, est l’un des grands mutualistes de la pensée, l’un de ceux qui dit s’inspirer des idées de ces autres qui sont socialement en-dessous de lui. Mais en vérité, il ne s’inquiète pas de ce que son vendeur de sushi pense ou rêve, il lui pompe surtout son énergie détruisant ainsi sa capacité à créer un monde meilleur. Parce qu’il a la prétention et le pouvoir de penser à sa place, de parler à sa place, et utilise ce pouvoir pour faire carrière.
D’un point de vue archéologique aucun site ne permet d’affirmer que la ville est née du besoin de sociabilité de l’homme. Pourtant, un site est présenté comme lieu d’origine : Göbekli tepe, en Anatolie. Selon l’archéologue Jens Notroff, Göbekli tepe témoignerait du passage de l’animisme à la religion, du nomadisme à la sédentarisation, de la chasse-cueillette à l’agriculture. Pour paraphraser ce que disent les images et les différents intervenants, les groupes de chasseurs-cueilleurs, las d’errer dans la poussière des plaines, désireux de se libérer de « l’obligation de suivre les troupeaux », mues par un désir inné de se regrouper, se réunirent et dressèrent des pierres qu’ils gravèrent pour symboliser une alliance encore inédite. Jens Notroff n’hésite pas à affirmer que les signes abstraits présents sur les blocs de pierre signifient clairement ce passage de l’animisme à la religiosité, puisque, dit-il, « Les représentations de l’art paléolithique en Espagne et en France se caractérisent essentiellement par la représentation d’animaux. » Cela est pourtant faux, l’art pariétal et mobilier du Paléolithique européen compte davantage de signes abstraits que de représentations figuratives. Se basant sur les représentations anthropomorphes sculptées sur les pierres dressées de Göbekli tepe, il dit également : « J’imagine qu’ils représentaient des ancêtres importants, qu’ils organisaient des grandes fêtes du travail. » Il ignore donc que des représentations monumentales existent également dans l’art paléolithique européen telle que celle du Roc-aux-Sorciers, ou que la composition de Lascaux n’a pu être réalisée sans une coopération importante des préhistoriques. À l’écouter, il semble établi que l’homme de la Préhistoire était animiste et que les chamanes étaient les ancêtres du prêtre. Pourtant, la théorie du chamanisme préhistorique, qui ne prend pas en compte les différences entre le chamane sibérien qui chevauche les esprits et le possédé africain qui est chevauché par les esprits[1], ne peut en aucun cas définir l’art de la Préhistoire. D’autre part, la continuité entre chamane et prêtre est une pure spéculation. Si toutes les études menées auprès des peuples premiers témoignent en faveur de l’importance qu’accorde l’homme au monde invisible, il est toutefois prudent de ne pas calquer ces modèles aux peuples de la Préhistoire. Il est dangereux qu’une hypothèse présentée comme certitude mette fin à la discussion. Pourquoi serait-il donc impossible d’imaginer que ces hommes de l’âge de pierre pouvaient simplement être émerveillés par la beauté du monde, ou pris d’un goût pour le jeu et les formes[2] ?
Il en est de même pour cette affirmation : la célébration et la création de monuments vont de pair. Rien n’interdit d’imaginer que les grottes, avec leurs somptueux drapés et excentriques, n’aient été le lieu de célébrations spirituelles, sacrées ou profanes. Que l’homme préhistorique n’ait pas éprouvé le besoin de dresser des pierres ne signifie nullement qu’il était dépourvu de spiritualité ou de sociabilité. L’histoire que nous raconte Jens Notroff est une fiction. Elle reprend le mythe de la caverne de Platon, et réduit l’histoire humaine à la vie d’homme : l’enfance, l’adolescence, la maturité, la mort. L’homme de la civilisation prend ses rêves pour des réalités et n’hésite pas à gommer tous les biais pour asséner des « vérités ». Parce que le civilisé, l’homme des villes, n’aime pas l’ignorance, il n’hésite pas à s’affirmer détenteur du savoir et à qualifier les péquenauds, les bouseux, ceux qui refusent le destin urbain de l’humanité, d’ignorants. La prétention de l’homme civilisé est telle qu’il préfère donner son avis sur tout et n’importe quoi plutôt que d’écouter ce que l’Autre pourrait éventuellement lui apprendre.
Jens Notroff déclare également que « les nomades n’étaient pas rattachés à un lieu particulier, du moins pas pendant longtemps. » Pourtant, de nombreux sites archéologiques témoignent de la complexité du territoire parcouru par les peuples de la Préhistoire. Ainsi, des sites semblent posséder des fonctions diverses : haltes de chasse, site d’abattage, site d’habitat, site d’agrégation. Le matériel archéologique témoigne de sites visités à des rythmes saisonniers et la circulation de certains vestiges (perles, coquillages, silex) prouvent qu’ils parcouraient leur territoire en connaissant parfaitement les gîtes de matières premières nécessaire à la confection de leurs outils[3]. Les préhistoriques détenaient un savoir que l’homme civilisé ne possède plus, un savoir bien plus essentiel. Il est plus que probable qu’Homo erectus même possédait une connaissance complexe du temps, de l’espace, des formes, de la vie et de la mort[4]. Enfin, il est important de noter que Jens Notroff ne se fatigue pas à différencier un organisme génétiquement modifié par sélection artificielle de celui modifié par transgenèse, il met tout dans le même sac. Au vu de ses capacités cognitives, de sa difficulté à nuancer, il n’est au final pas si surprenant que la richesse de la pensée des hommes de la Préhistoire lui échappe totalement.
Le deuxième volet s’attaque à cette « mauvaise habitude » qu’est la guerre. La guerre est le prix à payer pour la civilisation. Il est vrai que l’archéologie n’a, à ce jour, identifié aucun acte de guerre tout au long des 200 000 ans de la Préhistoire d’Homo sapiens. Le parti pris du réalisateur, plutôt que nier ou asséner « l’absence de preuve n’est pas une preuve de l’absence », accepte le constat des préhistoriens et, parce qu’il semble vraiment très doué pour ignorer la souffrance de ses semblables, il propose une explication simple : la destruction est créatrice. Bien qu’un certain nombre d’espèces et d’individus, anéantis par cette destruction créatrice, trouveraient certainement à y redire, il est vrai que jusqu’à ce jour, et malgré les innombrables guerres, le monde existe encore. Seulement, la destruction qui s’annonce pourrait bien mettre fin à ce jeu des analogies dangereuses : le jour et la nuit, le soleil et la lune, la guerre et la paix.
Ainsi, pour Peter Turchin, la guerre est un moteur de la civilisation puisque, comme le Dieu Shiva elle est à la fois destructrice et créatrice. Et tandis que Turchin se promène en conquérant, c’est l’image d’un félin tuant une antilope, des mains jouant aux échecs qui se dévoilent au spectateur. Le réalisateur ne recule devant aucun cliché, et l’image de l’homme comme roi des prédateurs et des stratèges n’est pas encore épuisée. Pourtant, la prédation du félin n’a absolument rien à voir avec les meurtres commis par les fins stratèges militaires. Malgré son ignorance des mondes sauvages qui vivent aux périphéries des villes, Turchin n’hésite pas à affirmer que « pour faire la guerre il faut penser en collectivité, convaincre les hommes d’oublier leur intérêt individuel pour le bien commun. Le sacrifice assurera la survie de leur village, mode de vie, culture. Le cycle de la violence renforce la cohésion d’un groupe. » Puisque pour lui la civilisation c’est la ville, que la ville c’est le savoir, que le prix du savoir c’est la guerre, et que cette histoire nous est raconté par un des tenants du « savoir », il est en effet inutile de prendre en compte la chair à canon, les gueules cassées, les morts pour la patrie, les campagnes saignées, les chevaux crevés dans les champs de bataille, les terres incendiées, les femmes violées et tuées, les enfants enrôlés ou violés puis tués, etc. Le savoir de ces gens-là c’est qu’un homme, une femme, un enfant ne valent pas un seul des pions de leur échiquier.
Peter Turchin affirme que la période la plus sanglante de l’histoire de l’humanité a été le passage du mode de vie des chasseurs-cueilleurs à l’agriculture. Il se base sur une application statistique qu’il applique aux événements historiques. Il serait intéressant de connaître les critères pris en compte pour juger de son résultat. Il semble assez étrange que le passage à l’agriculture ait été une période plus violente que celle que nous connaissons. Peter Turchin aurait-il plus d’informations sur ces périodes lointaines que n’en ont les archéologues ? S’il est exact que les premiers conflits apparaissent avec la domestication et la sédentarisation et qu’ils s’accentuent avec l’extraction des métaux, il est cependant impossible d’évaluer en pourcentage le taux de violence de ces époques. Les données archéologiques sont fragmentaires et ne permettent pas de chiffrer les populations, d’autant plus que de nombreux habitats, et surtout les plus humbles, laissent peu de traces, leur simplicité et les matériaux utilisés (bois, peaux, végétaux) ne pouvant résister à l’érosion et à l’enfouissement. De plus, le passage du Mésolithique au Néolithique s’est fait graduellement et sur une période de plus de 10 000 ans. En ce qui concerne l’histoire contemporaine, je me demande également si Turchin et son équipe prennent en compte les victimes de la pauvreté, des expropriations (des peuples indigènes par exemple), des réfugiés politiques et climatiques. Car toutes ces morts sont les conséquences de la guerre que mènent les pays du Nord contre les pays du Sud pour s’emparer de leurs minerais, des richesses de leur sol. Il est également étonnant de voir défiler à l’écran les grandes invasions, les grandes batailles, le nazisme, comme si toutes ces violences se valaient. Le réalisateur ne fait-il donc aucune différence entre la Commune de Paris et le nazisme, par exemple ? La loi du nombre est un leurre. Les sciences humaines sont prises dans l’étau des statistiques, mais la statistique ne permet d’appréhender que des moyennes et non la réalité.
Le réalisateur insiste : « avec la domestication, les hommes ne peuvent plus faire machine arrière, ils sont contraints d’aller de l’avant ». Pourtant, de nombreux peuples pratiquent l’horticulture ou l’élevage sans pour autant créer des villes, d’autres ont refusé l’agriculture ou l’ont abandonné pour revenir à une économie de chasse et de cueillette. La vision du paysan s’éreintant aux champs illustre le travail de la terre lorsque celui-ci doit produire pour une élite et pour la population urbaine. Un paysan qui travaille pour nourrir son unité domestique ne travaille pas autant. Il existe plusieurs manières de travailler la terre, comme la permaculture nous l’enseigne.
Le troisième volet est consacré à la religion, cet autre pilier de la civilisation. Les différents intervenants affirment que c’est elle qui nous unit les uns aux autres et qu’elle est « si essentielle à l’expérience humaine que notre cerveau est réceptif aux idées religieuses. » Pour les êtres humains, elle exprime le « besoin de demander aux Dieux de subvenir à leurs besoins, pour contrôler la nature, la plier à leurs volontés, pour la maîtriser physiquement, domestiquer les animaux, imposer leur loi à la nature. » Sans religion les hommes seraient donc des êtres solitaires, errants, faibles, malades, victimes de la grande méchante nature. D’épisode en épisode, les intervenants ne cessent d’étaler leur grande ignorance des communautés humaines qui refusent de vivre selon les lois de l’homme civilisé, qui ont vécu pendant des milliers d’années et qui existent encore de nos jours. N’étant pas à un mensonge près, le réalisateur nous apprend que c’est la religion et les rites qui ont rassemblé les hommes, ont participé à la formation, au maintien et à la cohésion des premières grandes sociétés. Pourtant, il semblerait que la religion soit apparue suite au développement urbain, avec l’accroissement d’une population qui perd peu à peu son autonomie face à une élite qui œuvre à sa domestication. Il ne faut pas, en effet, confondre la soumission à une force supérieure, ce qu’est la Religion, avec les croyances des peuples non civilisés, qui sont une communication avec le monde invisible afin de maintenir l’équilibre social, mental et naturel de la communauté. Comme nous l’enseigne la civilisation égyptienne, divinité et surveillance vont de pair. Ainsi, « on peut dire que les gens surveillés sont des gens gentils » puisque la surveillance a un impact sur notre comportement. D’ailleurs, c’est bien simple, « devant une église les gens donnent plus d’argent : les gens sont plus coopératifs et généreux lorsqu’on leur rappelle des concepts religieux, ou qu’ils sont près d’une église. Les gardiens de la moralité les surveillent et les jugent, ils sont donc plus coopératifs et donnent davantage. » Pour avoir une petite expérience de la mendicité, je peux affirmer que les endroits où j’avais le plus d’argent n’étaient pas près des églises, mais là où se promènent ceux qui ont de l’argent et qui, en grands seigneurs, se plaisent à montrer leur grande générosité. Je peux cependant admettre qu’avec une tirelire en métal et une soigneuse tenue de scout, on récolte en effet davantage devant une église qu’à la porte d’une librairie du 6ème arrondissement. En vérité, la surveillance ne rend pas plus gentil, elle muselle tout esprit critique et la paranoïa qu’elle distille rend l’homme craintif, méfiant, délateur, le mutile de son empathie et de tout courage, il suffit pour s’en convaincre de se souvenir de ce que sont les sociétés fascistes et totalitaires : de l’Allemagne nazi à l’Espagne franquiste, du Chili de Pinochet à la Corée du Nord. Malgré ce discours idéologique, il est intéressant de visionner le documentaire jusqu’à la fin afin de démasquer les stratégies de domination qu’il recèle. Ainsi apprenons-nous que pour ces adeptes de la civilisation, la religion est le facteur de cohésion dans l’histoire humaine, qu’elle permet de « développer un esprit d’entraide envers de plus en plus de gens. » Comme d’ailleurs l’ont démontré les guerres de religions, les croisades, l’Inquisition, etc. L’important au final, n’est pas tant que l’homme ait des dispositions innées pour la religion, mais qu’elle soit un outil efficace pour nous relier « à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de puissant et de divin. » Ce que ne dit pas le réalisateur, c’est que ce quelque chose de puissant et divin auquel le croyant se lie est un homme sanguinaire et psychopathe. Ce n’est pas pour rendre les gens plus gentils que l’œil d’Horus veille. Déclarer sans hésiter que « l’enfer est plus puissant que le paradis et un prêtre plus efficace que 100 policiers », c’est conseiller la surveillance de masse pour maintenir la cohésion et faire plier la nuque aux plus récalcitrants.
Il est également de bon ton depuis quelques années de dire que les pyramides égyptiennes ont été construites par des milliers d’ouvriers heureux de participer à cet ouvrage collectif. Ainsi, nous dit-on, « tout le monde participe parce que c’est quelque chose de sacré. » Cette affirmation permet d’évacuer le problème de l’exploitation de l’homme par l’homme et de prétendre, sous prétexte que la servitude égyptienne est différente de l’esclavage grec, que les ouvriers étaient des hommes libres. Imaginons des archéologues du futur affirmer que les ouvriers et tout le monde du XXIème siècle participaient à la construction d’une énième ZAC parce que c’était quelque chose de sacré. Si la ZAC est en effet sacrée, c’est pour les aménageurs. Dans un monde où la nourriture est entre les mains des dominants, elle n’est pour l’ouvrier qu’un moyen de subvenir à ses besoins élémentaires. Ainsi, ces généralisations sont mensongères et comme toujours valorisent l’histoire écrite par les spoliateurs. Il est vrai qu’aux âges obscurs de la Préhistoire la religion n’avait pas de raison d’être, l’humanité de ces temps-là n’était pas exploitée par des ogres prêts à dévorer jusqu’à leur propre demeure.
Le dernier volet est consacré au commerce. Quatrième pilier de la civilisation, il est celui qui la consacre tenant d’une main la confiance et de l’autre la paix. Jens Notroff nous dit que le cuivre est le premier produit fait de mains d’hommes qui circule en grande quantité et sur de longues distances. Encore une fois, c’est faux. Dès la Préhistoire, et plus particulièrement au Paléolithique récent, le silex dit du Grand-Pressigny circulait sur de longues distances, il était très apprécié pour sa grande qualité et ses propriétés intrinsèques qui permettaient au tailleur d’obtenir de grandes lames. À partir du Néolithique, c’est l’obsidienne, les haches polies en jade, cinérite, silex, les coquillages, les céramiques, etc., qui circulent. Bien qu’il soit souvent difficile de distinguer la circulation des personnes et des biens des échanges, il est aujourd’hui attesté que le troc existe bien avant l’apparition du cuivre. Rachel Botsman, consultante en stratégie, déclare : « au départ c’était assez basique, ça restait entre proche, je pouvais échanger de la nourriture contre une arme. » Si elle reconnaît l’existence du troc dès les débuts de l’humanité, affirmer que la nourriture était échangée contre les armes est un mensonge. Les données archéologiques attestent d’échanges d’objets exotiques et rares : perle, coquillage, roche belle et/ou de grande qualité. Les préhistoriques façonnaient leurs armes de chasse, leurs vêtements, et se procuraient leur nourriture. Cet exemple n’est pas anodin, il révèle ce qu’est la civilisation : un système coercitif, policier, dont l’économie est basée sur la spoliation de l’alimentation qui est une des principales sources de profits pour l’élite. Quant aux développement des armes, qu’il ne faut pas confondre avec les armes de chasse de la Préhistoire, elles sont au fondement même de la civilisation :
« Les inventeurs des bombes atomiques, des fusées spatiales et des ordinateurs sont les bâtisseurs de pyramides de notre temps : leur psychisme est déformé par le même mythe de puissance illimitée, ils se vantent de l’omnipotence, sinon de l’omniscience, que leur garantit leur science, ils sont agités par des obsessions et des pulsions non moins irrationnelles que celles des systèmes absolutistes antérieurs, et en particulier cette notion que le système lui-même doit s’étendre, quel qu’en soit le coût ultime pour la vie. »[5] (Lewis Mumford)
Mais peut-être pense-t-elle aux périodes plus récentes, celles qui commencent avec les premières extractions des métaux ? Si l’âge du cuivre, du bronze et du fer reconfigurent le système social, il ne faut pas oublier, comme l’indique Guillaume Roguet[6] dans son mémoire, que : « Ces mutations sur le long terme, visibles au travers de catégories maintenant bien étudiées et connues comme les sépultures et les dépôts non-funéraires puis au travers des objets qu’ils renferment, n’ont été cependant que peu appréhendées au travers d’une documentation qui se fait plus discrète et généralement plus humble : l’habitat. » Il ne fait aucun doute que l’exploitation du bronze puis du fer ont immédiatement intéressé les élites, mais il reste particulièrement difficile de rendre compte de la portée exacte des échanges dans la vie quotidienne, nos connaissances sur la Protohistoire étant en grande partie forgées par des dépôts, funéraires et non funéraires. Il est également souvent difficile de déterminer clairement si un site appartient à la catégorie des hameaux ou à celle des villages. Ainsi, lorsque le site de Dholavira est présenté aux spectateurs, par le biais d’une chercheuse, Uzma Rizvi, passionnée par les canalisations et la structure mathématique de la ville, il faut garder en tête que l’habitation des plus humbles est toujours la première à disparaître, pouvant être parfois si insignifiante qu’elle en est invisible. Ainsi en est-il encore avec nos sans abris qui dorment à même le sol, sous les ponts, dans le métro, lorsque cela est encore possible. Uzma Rizvi affirme cependant que les habitants de Dholavira étaient tous égaux, cultivés et libres et que : « Ce qui distingue Dholavira des autres sites c’est l’absence des palais monumentaux, on a une incroyable monumentalité au niveau de l’organisation et de l’agencement, de normalisation, une monumentalité de la pensée. On se croirait dans une ville moderne. Ils ont pris en compte l’environnement. Tout est planifié et orchestré, tout est contrôlé et réfléchi. » Une chose est sûre, Uzma Rizvi n’a pas tenu compte de l’environnement de Dholavira, elle l’isole des autres villes, villages et hameaux Harapéens, comme si une ville ne s’inscrivait pas dans un territoire plus large et complexe. Cette simplification permet au narrateur d’ajouter : « Ici les acteurs de la civilisation n’étaient ni les militaires, ni les bureaucrates, ni les religieux mais les marchands » Dholivara est présentée comme l’apothéose de la civilisation, l’exemple sur lequel le monde moderne devrait s’appuyer. Uzma Rizvi n’hésite pas à dire que « les gens mangeaient à leur faim, les rues étaient propres, il y avait peu d’inégalités et la paix régnait. » Mais d’où proviennent donc tant d’informations ? Des plaquettes écrites par l’élite marchande ?
Notre consultante en stratégie s’enflamme : « Avec le commerce est arrivée la paix et la civilisation a pris un tout autre visage, elle fonctionnait comme une entreprise moderne conçue pour maximiser ses propres avoirs en tissant un réseau souple d’intérêts communs. Désir d’échanges et de prospérité. Les pays qui commercent ensemble se font rarement la guerre. C’est la base d’une société civilisée. Commerce, prospérité, ville, production, consommation et civilisation. Les traders se sont substitué aux prêtres, et les pyramides ont cédé la place aux grattes ciel, monuments en notre foi en la prospérité. La confiance et le commerce s’entraînent mutuellement dans un merveilleux cercle vertueux. Pour faire des échanges il faut de la confiance… et les bénéfices sont exponentiels. Il faut faire confiance. Pour plus de liberté, d’autonomie, d’esprit d’entreprise, d’empathie humaine. »
La civilisation idéale, serait-elle une zone d’activité commerciale ? Tout cela ressemble étrangement aux villes imaginées et désirées par Richard Florida[7], chantre de la ville « créative, dynamique, innovante. » Pour cette élite intellectuelle, Dholavira serait donc l’ancêtre de Seattle.
Pour ces intervenants Dholavira aurait été un paradis terrestre, mais elle disparut tout de même, comme toutes les autres civilisations. L’explication qu’ils nous fournissent est remarquable : lorsque l’excédent commercial devient nul le tissu urbain se fissure et tout le système s’effondre. Belle propagande capitaliste qui menace le travailleur d’effondrement s’il refuse de participer à la création d’excédent commercial. Une seconde explication est donnée : la découverte d’un fossile humain touché par la lèpre fournit la preuve que le commerce sur de trop longues distances est vecteur de maladies et que la contagion peut aller jusqu’à causer l’effondrement d’une civilisation. Implicitement, ces récits nous plongent dans le cauchemar de l’extrême-droite : l’étranger comme vecteur de maladie. Est-il besoin de rappeler que l’usage de la maladie pour détruire une civilisation a été l’une des stratégies menées par les Européens contre les populations américaines ? Est-il nécessaire de rappeler les politiques actuelles menées par les gouvernements européens contre les réfugiés ? Certains diront que cela n’a rien à voir, qu’il faut parfois mettre de côté notre empathie et nos convictions pour être objectifs. Oui mais… une phrase, comme ça, en passant, qui n’a pas été coupée au montage, nous apprend que la région de Dholavira est devenue aride. Le réalisateur ne la retient pas, il préfère nous faire croire que ce sont la peste et la fissuration du système social qui sont responsables de l’effondrement. Pourtant, la peste ne cause pas l’aridification des terres. Par contre, la domestication des sols, comme nous le prouve encore chaque jour les bétonnages et monocultures, les appauvrit et stérilise. Les défenseurs de la civilisation sont des obsédés de la domestication, comme le prouve Jens Notroff, encore lui, qui s’émeut de la fin de cette merveilleuse civilisation de l’Indus, regrette que la nature ait repris ses droits, que la zone soit redevenue sauvage. Enfin, il est important de noter que la peste est transmise par les puces du rat, et que le rat n’a jamais été aussi proche de l’homme que depuis la domestication des céréales.
Ce que nous apprend ce documentaire c’est que la civilisation ne peut exister sans la ville, la guerre, la religion et le commerce. Ces quatre piliers forment le trône sur lequel vient s’asseoir le progrès, mot asséné sans relâche dans chaque épisode. Mais qu’est-ce que le progrès ? Le progrès, c’est l’innovation, l’avancée technologique, et rien d’autre. Il est ce dieu au nom duquel Tim Lambert et son équipe, suivant les volontés de l’élite dominante, nous demandent, à nous, les culs terreux, les domestiques, les ouvriers, les paysans, les femmes, les sans-abris, les incultes, de trimer sans nous inquiéter ni poser de questions. Ils nous demandent d’offrir notre confiance et notre force de travail à ce dieu, afin d’œuvrer pour quelque chose de plus grand, de plus glorieux que nos misérables vies individuelles. Ils souhaitent ardemment que nous travaillions ensemble pour qu’ils pensent, jouent, se goinfrent à notre place. Comme ils aimeraient que nous cessions de douter de leur générosité et de leur philanthropie ! Pour ceux qui en doutaient encore, ce qu’ils s’acharnent à nous enfoncer dans le crâne, à travers leur propagande insidieuse, c’est toujours et encore le mythe du progrès, et les outils dont ils usent pour maintenir et accroître leur domination sont la ville, la guerre, la religion, le commerce… et les médias, à travers lesquels ils réécrivent et falsifient l’histoire. Ce sont ces piliers qu’il nous faut détruire pour ne plus être dépossédés de nous-mêmes, de notre nourriture, de notre santé, de notre vie, de notre Terre et pour retrouver le savoir de nos ancêtres. Aux origines des civilisations n’est pas un documentaire mais un roman mensonger au service de l’élite, que le père de l’industrie de la propagande et des « relations publiques », Edward Bernays, dont les recommandations sont toujours soigneusement mises en pratique, n’aurait pas renié. Et le progrès qu’il nous vend n’est pas autre chose que la mécanisation et l’informatisation du vivant au service d’une minorité démente[8].
Ana Minski
- http://mitaghoulier.blogspot.com/2014/12/les-chamans-de-l... ↑
- http://mitaghoulier.blogspot.com/2018/01/art-prehistoriqu... ↑
- Territoires, déplacements, mobilité, échanges durant la Préhistoire, sous la direction de Jacques Jaubert et Michel Barbaza, CTHS, 2005 ↑
- http://mitaghoulier.blogspot.com/2017/12/les-premisses-de... ↑
- http://partage-le.com/2015/05/techniques-autoritaires-et-... ↑
- Archéologie sociale de l’habitat de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer dans le Bassin parisien (2200–460 avant notre ère), Guillaume Roguet ↑
- Les « créatifs » se déchaînent à Seattle, Grandes villes et bons sentiments, Le monde diplomatique, novembre 2017, https://www.monde-diplomatique.fr/2017/11/BREVILLE/58080 ↑
- http://partage-le.com/2018/07/les-ultrariches-sont-des-ps... ↑
00:21 Publié dans culture, manipulation, oppression, propagande | Lien permanent | Commentaires (0)



